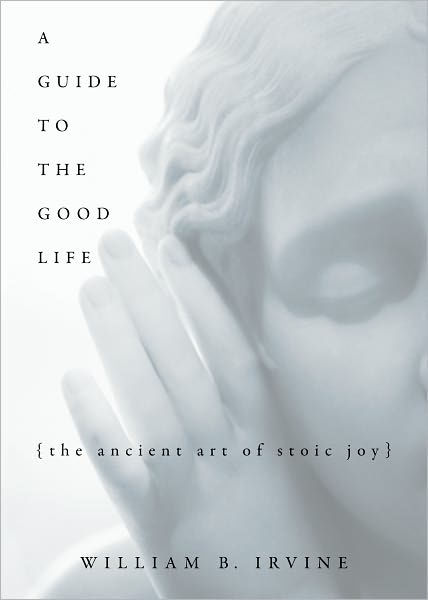
Introduction
Dans les trente dernières années, l’intérêt pour la philosophie stoïcienne a subi une croissance, tant dans les sphères populaires que philosophiques. La « redécouverte » qui s’est opérée est intéressante, car le matériel source ne semble pas être interprété de la même manière par tous ses lecteurs. Il est récurrent que cela se produise dans l’histoire de la philosophie. Cependant, nous avons, dans le cas des réinterprétations contemporaines du stoïcisme, l’opportunité de pouvoir les analyser au même moment qu’elles se développent et impactent leur environnement intellectuel. Il serait impossible de faire l’état des lieux complet des travaux qui contribuent au phénomène des réinterprétations contemporaines du stoïcisme en une série de cinq articles. Néanmoins, il paraît pertinent de faire un panorama large du sujet, afin d’encourager les lecteurs à se pencher sur une thématique qui marque notre époque dans les domaines de la philosophie et de la sociologie.
L’analyse des stoïcismes contemporains proposée dans cette série d’articles a commencé par décortiquer en quoi consistait le « New Stoicism » de Lawrence C. Becker. Dans cet opus, nous avons vu que la première réinterprétation contemporaine par un philosophe se place en continuité avec les versions populaires de l’Antiquité, en adaptant leur contenu, mais en maintenant la structure tripartite et holistique propre au stoïcisme (logique, physique, éthique). Le fond de la pensée beckerienne est que le stoïcisme aurait évolué avec nos découvertes intellectuelles, pour devenir un agrégat de nos meilleures théories scientifiques, de notre logique contemporaine et d’une éthique normative actuelle. Dans le deuxième article de la série, nous avons discuté du « Reformed Stoicism » de Piotr Stankiewicz. La raison pour laquelle nous avons traité de cette approche dans le deuxième opus était dans le but de contraster la vision de Becker le plus vite possible à une vision qui se place totalement à l’opposé du spectre stoïcien. En effet, Stankiewicz propose une réinterprétation qui se sépare totalement d’une structure orthodoxe, afin de cibler la valeur prudentielle de l’éthique. Selon le « Reformed Stoicism », ce qui compte est notre capacité à formuler des récits qui ne cherchent pas à être conformes à la réalité, mais combattent nos perceptions négatives de la réalité, qui nous causeraient du tort. L’importance mise sur les différents aspects stoïciens varie donc grandement d’un auteur à l’autre, ce qui nous pousse à nous questionner sur les conditions nécessaires et suffisantes pour que ces théories puissent encore être qualifiables de stoïcisme. Puis, nous pouvons même nous demander s’il est réellement possible de qualifier quelque chose de « stoïcisme contemporain ». Pour répondre à ces questions, nous devons continuer notre parcours à travers les réinterprétations contemporaines. De fait, notre analyse s’enrichit au fur et à mesure que nous avançons dans cette série. Ainsi, nous allons donc nous pencher sur une troisième réinterprétation par un philosophe, le « Reconsidered Stoicism » de William B. Irvine. Nous l’analyserons principalement par le biais de son œuvre nommée A guide to the good life: The ancient art of stoic joy, parue en 2009. Puis nous apporterons des critiques s’articulant conjointement avec l’article de Maël Goarzin, qui présente plus en détail la posture du philosophe en question.
William B. Irvine et le « Reconsidered Stoicism »
Constat et accusations
Tout comme Becker et Stankiewicz, Irvine constate deux choses : le stoïcisme a quasiment disparu pendant un millénaire et demi, et le stoïcisme serait pertinent à son époque. Néanmoins, contrairement aux deux premiers auteurs, Irvine estime que l’environnement intellectuel du XXème siècle et du début du XXIème siècle n’est pas propice au développement du stoïcisme, tant sur les plans philosophiques, que politiques et psychologiques. En effet, il accuse ces trois domaines d’adopter des paradigmes de pensée qui influenceraient les individus à adopter des croyances et des opinions contraires à la doctrine qu’il défend. Pour comprendre ce propos, il convient de développer ses arguments.
Premièrement, il accuse la philosophie, principalement du XXème siècle et en tant que champ d’étude, d’avoir accordé trop d’importances aux questions de la philosophie du langage et de la logique. Nous reconnaissons ici une critique effectuée à la philosophie analytique très présente dans les universités, mais aussi une première mention des stoïciens de l’Antiquité. En effet, Irvine mobilise Épictète, pour mettre en garde le philosophe qui s’adonne qu’au domaine de la Logique, en ignorant la partie Éthique de la philosophie. En plus d’émettre une critique à la philosophie en tant que champ d’étude, il traite aussi des tendances actuelles d’adhésion à des courants de philosophie pratique. De fait, l’auteur estime que l’épicurisme et le scepticisme ont une place plus importante que le stoïcisme dans le climat philosophique actuel.
Deuxièmement, Irvine entrevoit l’idée que les décisions politiques contemporaines rendent difficile d’avoir une attitude compatible avec le stoïcisme. Effectivement, l’auteur relate le fait que les politiciens actuels tendent à retirer la responsabilité de l’individu quant à sa mauvaise condition vie, en accusant les gouvernements de ne pas remplir les besoins des habitants de leur nation. En ce sens, les états encouragent les personnes à ne pas réfléchir au contrôle qu’ils ont sur leur situation au sein de leurs nations.
Troisièmement, l’auteur pense que la psychologie contemporaine s’oppose au stoïcisme, car elle encourage l’individu à entreprendre une relation positive avec ses émotions négatives, en les acceptant et les normalisant, pour mieux les traiter. Pour Irvine, un tel fonctionnement est un échec, car c’est une aberration d’un point de vue stoïcien d’accepter une émotion négative, alors que la philosophie qui nous intéresse regorge de ressources pour éviter de les subir et qu’il vaut mieux suivre cette voie. Pour appuyer sa critique de la psychologie contemporaine, l’auteur évoque le désastre d’Aberfan. La catastrophe que mobilise Irvine est un événement où un glissement de déchets d’une mine au Pays de Galles a causé la mort de la majorité des élèves d’une école primaire. À la suite de cette tragédie, certains parents d’élèves auraient sollicité l’aide de psychologues, mais Irvine affirme que ceux ne l’ayant pas fait auraient mieux réussi à gérer leurs émotions. Ainsi, non seulement le paradigme actuel est contre le stoïcisme, mais il serait aussi moins efficace.
Finalement, le dernier point qui empêche le stoïcisme de se développer actuellement serait la préconception des individus qui présente le stoïcisme comme quelque chose qui demande une discipline trop exigeante. En effet, il accuse les personnes qui pensent ainsi de préférer assouvir tous leurs désirs, plutôt que d’apprendre à les contrôler.
Le constat tiré par Irvine est clair : le climat intellectuel actuel est anti-stoïcien. Cependant, cela ne retirerait pas le fait que la théorie puisse nous être profitable. Bien qu’Irvine défende l’utilité du stoïcisme, cela n’implique pas que tout est à garder. De fait, l’auteur ne propose pas d’adopter le « Traditional Stoicism »[1], mais il présente une nouvelle adaptation des versions antiques. Ainsi, il convient de se pencher sur la réadaptation de William B. Irvine : le « Reconsidered Stoicism ».
Le fonctionnement du « Reconsidered Stoicism »
Pour commencer, le stoïcisme reconsidéré est défini comme une « philosophie de vie ». Selon Irvine, qualifier ainsi le « Reconsidered Stoicism » implique deux conséquences. Premièrement, la doctrine a une vocation prescriptive, ce qui veut dire qu’elle nous indique ce que nous devrions vouloir dans notre vie et ce que nous devrions éviter. Deuxièmement, elle doit nous donner un mode d’emploi pour nous indiquer comment obtenir ce qui devrait être poursuivi.
Pour Irvine, les stoïcismes de l’Antiquité nous indiquent très clairement ce que nous devrions chercher à obtenir : la tranquillité, comprise comme un « état psychologique dans lequel nous expérimentons peu d’émotions négatives, comme l’anxiété, le deuil, la peur, mais une abondance d’émotions positives, en particulier la joie »[2]. Pour atteindre cette situation, l’auteur mobilise une série de quatre conseils pratiques, que les anciens auraient distinctement donnés dans leurs versions. Dans un premier temps, il faut employer notre raison pour nous débarrasser des émotions négatives. Dans un second temps, il faut s’associer à des individus bons et entretenir des relations amicales avec des personnes que nous estimons avoir des bonnes valeurs. Dans un troisième temps, il faut dépasser l’envie qui nous pousse à vouloir toujours plus, en méditant sur la nature éphémère des choses. Dans un quatrième temps, il faut mettre de l’importance sur ce qui dépend de nous et que nous contrôlons. En plus de ces quatre points, Irvine ajoute deux prescriptions. D’abord, si nous sommes nés dans des circonstances économiques bonnes, nous sommes dans notre droit de profiter des moyens que nous avons. Puis, il est important de reconnaître le caractère fataliste du monde.
Pour justifier ces prescriptions, les anciens ont fait usage d’une structure tripartie holistique, en passant par des positions que les philosophes que nous avons traitées dans cette série d’articles qualifient de métaphysiquement trop lourdes. Irvine ne se distingue pas sur ce plan, mais il se rapproche de Becker, puisqu’il mobilise les sciences actuelles pour justifier son point de vue. L’emploi de la science reste tout de même très différent, car il ne cherche pas à l’utiliser pour remplacer les aspects problématiques des versions antiques, mais pour expliquer l’origine des maux que nous devons outrepasser pour atteindre la tranquillité.
Selon Irvine, les émotions négatives et les pulsions que nous ressentons naissent de processus évolutionnaires ayant contribué à notre survie et à l’essor de notre espèce. Pour commencer, il explique que le caractère jouissif du sexe est un attribut qui a poussé les individus à se reproduire. Ensuite, nos ancêtres, qui étaient de nature anxieuse et craintive, auraient mieux survécu, car ils auraient pris des dispositions pour éviter des situations difficiles et dangereuses. Par ailleurs, Irvine affirme que si nous cherchons à avoir de la reconnaissance sociale, c’est parce que les individus ayant eu moins de côte sociale ont vu leurs ressources amoindries. De plus, le fait d’avoir moins de reconnaissance à l’échelle sociale empiéterait sur le taux de reproduction d’un individu et impacte donc directement sa capacité à perpétuer l’espèce. Finalement, la capacité de raisonner est aussi un héritage de nos ancêtres, puisque les membres de l’espèce pouvant faire un meilleur usage de la raison ont des meilleures chances de survie. Ainsi, les outils affectifs et cognitifs qui sont à même de nous causer du tort sont des héritages d’individus ayant eu des meilleurs instruments pour survivre et se reproduire.
Le problème que soulève Irvine est que la condition de vie de l’être humain a changé de sorte à rendre caduques ces capacités et que celles-ci sont devenues incapacitantes et nocives pour notre bien-être. De fait, l’humanité n’est plus dans une position où l’objectif est de survivre, mais où il correspond à être heureux et tranquille. Pour illustrer cette impression, l’auteur avance que la crainte et l’anxiété, dues au besoin de chercher de quoi se nourrir le lendemain, ne sont plus pertinentes dans nos sociétés, car les structures sociales garantissent une protection contre la faim.
Pour se débarrasser des émotions négatives, qui tourmentent notre existence et empêchent d’atteindre la tranquillité, il faut avoir recours à une des composantes dont nous avons héritées. Préalablement mentionnée, la raison est quelque chose que notre espèce a développée par le biais d’un processus biologique. Puis, c’est cette compétence qui permet à l’être humain de pallier aux maux que nous avons. Nous pouvons souligner ici qu’Irvine rejoint Becker, tantôt sur l’origine de la raison et tantôt sur son utilité. L’auteur se rapproche aussi des versions antiques sur l’importance d’effectuer des exercices pratiques pour notre bien. En effet, pour préserver la tranquillité si convoitée, nous devons imaginer le pire et nous mettre dans des situations qui sollicitent l’application de la raison, car ces exercices permettent de favoriser des réponses émotionnelles appropriées lors des scénarios catastrophes qui peuvent surgir. Au moment d’écrire A guide to the good life: The ancient art of stoic joy, Irvine pressent une critique sur cette partie. Effectivement, nous sommes à même de lui demander si, au lieu de passer par des exercices pratiques ardus, il ne serait pas plus facile de se médicamenter pour arriver à la tranquillité qu’il évoque. Pour y répondre, il explique que ces exercices ont des effets secondaires qui sont bénéfiques pour celui qui pratique, notamment une hausse dans la confiance en soi. Néanmoins, l’auteur ne voit pas le « Reconsidered Stoicism » comme une méthodologie qui convient à tout le monde. Selon Irvine, le stoïcisme reconsidéré sera naturellement plus compatible avec certaines personnalités que d’autres. Nous retrouvons ici une similitude avec Stankiewicz, qui explicitait que son « Reformed Stoicism » n’est pas un objectif universel. Toutefois, il faut nuancer les raisons pour lesquelles cela est le cas pour chaque auteur. Pour Stankiewicz, le stoïcisme réformé n’est pas pour tout le monde, car certains individus ne cherchent tout simplement pas le bonheur. Il emploie un exemple curieux, mais il suggère que certains artistes n’ont pas pour but d’être heureux et ont comme objectif de créer sans s’exalter dans ce processus. Irvine, quant à lui, pense que le « Reconsidered Stoïcism » n’est pas pour tous, car il existe d’autres philosophies de vie, qui résonnent mieux avec différents individus. Le seul point additionnel qu’ajoute Irvine, et qui semble indiquer une supériorité du stoïcisme reconsidéré, est qu’il vaut mieux avoir une philosophie de vie moins idéale que de ne pas en avoir.
Le « Reconsidered Stoicism » est donc une réappropriation des stoïcismes antiques, qui fixe comme objectif principal un état cognitif et affectif de tranquillité. Pour y parvenir, il faut dépasser, par le biais de la raison, les émotions négatives, qui sont des héritages de l’évolution devenus caducs. Finalement, l’emploi de la raison relativise ces maux en faisant des exercices pratiques cautionnés par les stoïciens de l’Antiquité. À la suite de cette présentation du « Reconsidered Stoicism », nous pourrions poursuivre sur les conséquences qu’elle a sur l’analyse des conditions nécessaires et suffisantes pour être qualifiable de stoïcisme. Néanmoins, il paraît pertinent de revenir sur ce qui a été dit, mais cette fois-ci avec un regard critique.
Critique du « Reconsidered Stoicism »
Dans ce travail, nous avons commencé par exposer l’analyse que fait Irvine du climat intellectuel de son époque et à quel point celui-ci est propice à accueillir du stoïcisme en lui. À la suite de son enquête, l’auteur conclut que la politique actuelle, la psychologie d’aujourd’hui et la philosophie contemporaine sont défavorables à un développement du stoïcisme. Toutefois, nous ne sommes pas en accord avec le compte-rendu effectué par Irvine et il convient d’exposer pourquoi cela est le cas.
Pour ce qui est de son analyse du climat politique, l’auteur avance que les politiciens sont la cause d’une décharge de culpabilité par la population sur les institutions publiques. Néanmoins, ce ne serait pas dû à leurs décisions politiques, mais à cause de discours cherchant à obtenir la faveur des habitants. Si nous nous penchons sur la situation socio-politique dans laquelle Irvine écrit son premier livre, il est vrai que nous retrouvons une hausse en revendications et discours apologétiques, notamment due à la crise des subprimes, ayant exposé la mauvaise gestion du secteur immobilier et financier par les gouvernements. Cependant, ce ne sont pas les discours qui ont causé un mouvement d’attribution de blâme aux gouvernements, mais leur incompétence, leurs décisions irresponsables et la précarité fulgurante qui en découle. Pour pallier ces problèmes, il est évident que les populations se tournent vers leurs dirigeants, afin qu’ils réparent leurs erreurs. Toutefois, ça n’a aucunement été la seule action entreprise par les individus, puisque, dans les situations difficiles, chacun cherche à se préserver par ses propres moyens. L’analyse politique d’Irvine est critiquable aussi, car le système capitaliste et individualiste dans lequel nous vivons ne semble pas anti-stoïcien. De fait, il tend à attribuer la cause du sort de l’individu à ses propres actions, en convainquant la population qu’il existe une forme de méritocratie. En ce sens, le système actuel n’est pas hostile au stoïcisme, mais est incroyablement favorable à celui-ci, car il met une emphase importante sur le contrôle que nous avons sur nos actions, sur notre condition et sur notre bonheur. Un dernier fait qui a montré la compatibilité du stoïcisme avec notre climat socio-politique est l’accroissement du nombre de collectifs stoïciens généré par l’importance qu’à pris l’Internet dans ce millénaire. Par le biais de blogs en ligne, des personnes mises en difficulté par le climat politique et employant le stoïcisme pour mieux vivre ces événements ont pu se rencontrer et partager leurs pensées. Ainsi, l’analyse qu’effectue Irvine ne rend pas compte du fait que le stoïcisme est fortement compatible avec le climat politique de son temps, notamment parce que celui-ci rend responsables les individus pour leur sort, malgré les problématiques qui sont dues à un système capitaliste.
Pour ce qui est de son analyse du climat philosophique, il semble que cette série d’articles ait continuellement démontré qu’elle est erronée. Bien qu’il soit vrai que la tradition analytique, largement présente dans les universités anglo-saxonnes et germanique, s’est principalement penchée sur les questions de philosophie du langage et de logique, les auteurs comme Pierre Hadot, Lawrence C. Becker et Julia Annas ont montré qu’il y avait de l’intérêt philosophique pour les courants de l’Antiquité, dont le stoïcisme. Par ailleurs, peu après la période dans laquelle paraît le premier livre d’Irvine, plusieurs collectifs stoïciens sont nés dans la sphère académique (notamment Modern Stoicism, une institution formée à l’université d’Exeter en 2012). En plus de ce point-là, nous nous permettons de critiquer l’affirmation d’Irvine qui dit que le stoïcisme est moins favorisé que l’épicurisme et le scepticisme, par la population générale. Il existe actuellement des weblogs, tels que The Daily Stoic, avec plus de 300’000 abonnés et plusieurs d’entre eux, dont la New Stoa, existaient déjà au moment où Irvine lance son premier livre. Ainsi, il n’est pas possible d’affirmer à son époque que les personnes favorisent d’autres philosophies hellénistiques, alors qu’elles n’ont quasiment aucune présence dans la sphère populaire. Puis, nous voyons clairement que le monde académique s’intéressait au stoïcisme plus d’une décennie avant la parution d’A guide to the good life: The ancient art of stoic joy.
Concernant son compte-rendu du rapport entre le stoïcisme et la psychologie contemporaine, nous sommes à nouveau dans une position contraire à celle d’Irvine. En effet, si nous nous penchons sur les méthodologies employées pour la gestion d’émotion en psychologie, nous trouvons non seulement un climat favorable au stoïcisme, mais une inspiration de celui-ci. De fait, la thérapie cognitivo-comportementale (TCC), méthode psychologique développée au XXème siècle et employée pour traiter des patients atteints d’anxiété et de dépressions, est une technique qui reconnaît de manière explicite le stoïcisme comme base philosophique de sa pratique. Par ailleurs, nous critiquons le fait qu’Irvine qualifie l’acte de reconnaissance de l’émotion négative comme anti-stoïcienne, car l’action est conciliable avec les versions antiques du stoïcisme et son interprétation reconsidérée. En réalité, reconnaître une émotion négative peut être une indication d’une analyse de son fonctionnement cognitif, dans le but de mieux gérer l’émotion et s’en débarrasser. Adaptée au « Reconsidered Stoicism », la reconnaissance de l’émotion négative peut être la première étape vers le maintien de la tranquillité. Ainsi, nous avons donc vu à quel point le climat politique, philosophique et psychologique, au moment de la parution des propos d’Irvine, ne semblent pas être conformes à l’analyse qu’il avance. Bien que nos critiques soient importantes, elles ne traitent pas directement la théorie du « Reconsidered Stoicism ». Il convient donc de développer celles qui portent directement sur sa réappropriation.
L’adaptation d’Irvine est intéressante, car elle définit le « Reconsidered Stoicism » comme une « philosophie de vie », plutôt que de courant philosophique. La distinction est importante, car elle nous permet de cerner que l’intention de l’auteur est de se centrer sur l’applicabilité et l’utilité que peut avoir sa doctrine dans la vie de tous les jours. L’idée qu’elle est jugée par sa valeur pratique la rapproche du « Reformed Stoicism » de Stankiewicz, mais elle mobilise tout de même des méthodes de justification liées aux sciences. En ce sens, son adaptation se rapproche de celle de Becker, mais elle emploie la biologie d’une manière très distincte. Le but de l’emploi des sciences est de montrer la dissonance pénible entre l’objectif initial des émotions négatives et notre réalité contemporaine. Si nous pensons à notre expérience personnelle, nous pouvons quasiment tous trouver des exemples où cela est le cas. En effet, toute personne ayant vécu une insomnie due à l’anxiété a déjà ressenti l’impression que ses émotions ne coopèrent pas avec ses besoins immédiats. Bien que cet exemple soit probant, il ne suffit pas pour valider le reste du point de vue d’Irvine, car son analyse repose sur ce qui semble être une ignorance de la réalité économique dans laquelle il vit. Un exemple de cela surgi lorsque l’auteur affirme que l’anxiété autour de son rang social n’a aucun sens aujourd’hui, car les lois empêcheraient une personne de se faire voler sa nourriture ou se retrouver sans quoi se nourrir, à cause de son standing social. L’exemple en question est non seulement aberrant, car il ne rend pas compte du fait que le concept de caste social s’étend aussi sur des questions économiques et financières, mais parce qu’il n’est tout simplement pas vrai que cette situation ne se produit plus à son époque. Pour appuyer notre propos, la crise des subprimes, en 2008, aurait placé plus de 97 millions de personnes en situation de famine[3], ce qui indique que l’absence de nourriture engendrée par sa situation sociale était une réalité importante au moment où l’auteur écrit. Il est donc parfaitement concevable qu’une personne ressente actuellement de l’anxiété concernant son prochain repas, puisque ce n’est pas quelque chose de révolu, mais un fait de vie pour la majorité des êtres humains du monde.
Dans cette sous-partie, nous avons relevé des points qui indiquent que l’analyse du climat intellectuel d’Irvine ne semble pas refléter la réalité et que les émotions qu’il estime néfastes et inutiles, sont des outils pertinents pour une majorité de la population. Que son compte-rendu et ses arguments proviennent d’une position de privilège ou une vision de la société particulièrement centrée sur les nations riches et industrialisées, il n’empêche que sa théorie peut encore avoir une utilité pratique. Nous avons souligné qu’il est parfois vrai que nous puissions avoir des émotions qui gênent notre bien-être, comme l’anxiété la veille d’un examen, alors que nous l’avons bien préparé. Puis, nous pouvons concevoir que la tranquillité serait préférable dans ces situations et que relativiser par la raison est un bon outil. Il existe donc des cas où sa théorie est pratique et il convient de mentionner qu’il est évident qu’elle repose sur des concepts stoïciens. Contrastons donc le « Reconsidered Stoicism » avec les versions antiques et contemporaines déjà vues, tout en concluant sur l’impact qu’a cette réappropriation sur les conditions nécessaires et suffisantes pour être du stoïcisme
Conclusion et réflexions
Dans les sous-parties précédentes, nous avons vu que William B. Irvine a émis une analyse qui pose le stoïcisme comme étant pertinent, mais compliqué à développer, car le climat intellectuel actuel ne le permettrait pas. Par ailleurs, il semble constater que les émotions négatives que nous vivons, sont le fruit d’un processus évolutionnaire devenu caduc. Pour pallier ces problématiques, l’auteur développe une version modifiée du stoïcisme, de sorte à obtenir une version qui rend compte de la société actuelle. Le « Reconsidered Stoicism » a donc comme base des concepts stoïciens, tels que l’importance de la pratique, l’aspect souhaitable de la tranquillité et la volonté de se débarrasser des affects malsains. Toutefois, ils ne sont pas compris de la même manière que dans les versions antiques. En effet, la pratique est importante, mais elle est ici une prescription non-universelle, car le « Reconsidered Stoicism » ne se veut pas applicable pour tous. Ensuite, la tranquillité est perçue comme l’objectif central de la théorie d’Irvine, mais elle n’est qu’un effet secondaire de l’objectif principal le plus mis en avant par les versions antiques : l’eudémonie. Puis, bien que les émotions négatives ne soient pas enviables dans les toutes les versions du stoïcisme, les anciens les voient comme découlant des impressions et non-pas de l’évolution.
Si nous contrastons le « Reconsidered Stoicism » aux autres adaptations contemporaines que nous avons vues, nous retrouvons aussi des points de comparaison intéressants. Premièrement, d’un point de vue structurel, il semble qu’Irvine se situe entre Becker et Stankiewicz. Effectivement, il ne maintient pas la structure tripartite et holistique commune en Antiquité, comme Becker, mais il met une importance sur les sciences et leur valeur dans la justification de son positionnement éthique. Un autre point de rapprochement avec le « Reformed Stoicism », que nous avons déjà mentionné, est le caractère non-universel de sa théorie. Si pour Becker, le « New Stoicism » est la voie à suivre pour tous, cela n’est évidemment pas le cas pour les deux autres. Par ailleurs, Stankiewicz et Irvine semblent aussi s’accorder sur le caractère fondamentalement orthopraxique du stoïcisme. Nous n’essayons pas de dire que le « New Stoicism » ne met pas d’importance sur la pratique, mais simplement que l’emphase mise dessus par les deux autres est plus explicite. À la suite de ces points de comparaison, nous sommes à même de nous demander comment ceux-ci se reflètent dans les possibles conditions nécessaires et suffisantes pour être du stoïcisme.
- Dans l’article précédent, nous avions évoqué que la structure tripartite et son aspect holistique pouvaient difficilement être des conditions nécessaires, si le « Reformed Stoicism » était considéré comme une forme de stoïcisme. La même conclusion est obtenable si le « Reconsidered Stoicism » en est une, car elle ne perpétue pas cet aspect. Néanmoins, si l’œuvre de Stankiewicz ne l’est pas, nous pourrions avancer qu’une condition pertinente serait le fait d’accorder de l’importance à la science ou la Physique. La proposition est attirante, mais elle implique de ne pas compter Ariston de Chios parmi les stoïciens, ce qui est un grand parti pris.
- Une autre condition nécessaire ou suffisante traitée était le fait qu’il faille traiter de thématiques ou de notions similaires aux versions antiques. Tout comme les autres itérations contemporaines, la forme présentée par Irvine s’intéresse aussi aux questions de la mort et de la vie bonne. Néanmoins, ce qu’elle traite en particulier est la notion de tranquillité et elle est la seule à y placer autant d’importance. Bien qu’elle se distingue quelque peu des deux autres, nous pouvons considérer qu’elle remplit cette condition.
- . Le « New Stoicism » et le « Reformed Stoicism » se rapprochent dans l’idée qu’ils s’accordent sur des doctrines phares et, sur ce point, le « Reconsidered Stoicism » rejoint ses contemporains. Toutefois, il semble que nous devions redéfinir la condition qui les rapproche, car le seul point où ces trois doctrines s’accordent est sur le fait que l’être humain a une forme d’agentivité qui mène au bonheur. Ainsi, la condition nécessaire ou suffisante qui rattache les trois semble être plutôt qu’il faille mettre de l’importance sur le contrôle que l’être humain a pour être heureux.
- La dernière potentielle condition pour être considéré comme une forme de stoïcisme est celle qui demande réadaptations contemporaines d’avoir au moins l’intention de faire usage de la philosophie stoïcienne antique comme base de réflexion, de manière consciente ou inconsciente. Le « Reconsidered Stoicism » la remplit, mais nous nous rendons compte qu’elle peut difficilement être une condition suffisante, car ce n’est pas parce que nous avons l’intention d’être une chose, que nous la sommes. Ainsi, cette condition très intéressante, ne peut qu’être nécessaire.
Au premier abord, le « Reconsidered Stoicism » n’a pas bouleversé nos candidatures au poste de condition nécessaire ou suffisante pour être du stoïcisme. Néanmoins, il a permis de réaffirmer des modifications apportées lors du dernier article. Par ailleurs, nous entrevoyons la complexité d’articuler la pluralité des réappropriations entre elles, car elles semblent avoir plus de différences que de points communs. Ce sentiment risque de croître, car le prochain article de cette série se penchera sur les multiples réadaptations effectuées par les milieux externes à la philosophie. Le « stoicisme populaire » qui découle des sphères non-philosophiques sera donc le dernier article, avant de répondre aux deux questions qui motivent cette série : est-ce qu’il y a des stoïcismes contemporains ? Si oui, quelles sont les conditions nécessaires et suffisantes pour être considéré comme tel ?
Références
- « Global Food Crises, 2008 vs 2022: Report finds disparities in hunger and funding», Care (site en ligne), <https://www.care.org/media-and-press/global-food-crises-2008-vs-2022-new-report-finds-disparities-in-hunger-and-funding/#:~:text=The%20number%20of%20undernourished%20people%20decreased%20by%2095%20million%20after,2009%2C%20when%20adjusted%20for%20inflation.>, (réf 31.03.2025).
- Epictète, Entretiens : livres I à IV, Paris : Editions Gallimard, 1993.
- Epictète, Manuel d’Epictète, Paris : Flammarion, 2015.
- Goarzin, Maël, « A guide to the good life (William Irvine) », Stoa Gallica (site en ligne), <https://stoagallica.fr/a-guide-to-the-good-life-william-irvine/> (réf 11.04.2025).
- Gourinat, Jean-Baptiste, « Le stoïcisme hellénistique », Le stoïcisme, Presses Universitaires de France, 2017. pp.7-83.
- Irvine, William B., A guide to the good life: The ancient art of stoic joy, Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Martinez, Tristan, « Les stoïcismes contemporains (1) : le « New Stoicism » de Lawrence Becker », Stoa Gallica (site en ligne), <https://stoagallica.fr/les-stoicismes-contemporains-1-le-new-stoicism-de-lawrence-becker/>, (réf.25.02.2025).
- Martinez, Tristan, « Les stoïcismes contemporains (2) : le « Reformed Stoicism » de Piotr Stankiewicz », Stoa Gallica (site en ligne), < https://stoagallica.fr/les-stoicismes-contemporains-2-le-reformed-stoicism-de-piotr-stankiewicz/>, (réf. 31.05.2025).
[1] Position philosophique actuelle qui incite à adopter une forme de stoïcisme qui promeut des doctrines particulièrement proches de celles de l’Antiquité.
[2] Irvine, William B., A guide to the good life: The ancient art of stoic joy, Oxford: Oxford University Press, 2009, p.226, traduit par moi-même.
[3] « Global Food Crises, 2008 vs 2022: Report finds disparities in hunger and funding», Care (site en ligne), <https://www.care.org/media-and-press/global-food-crises-2008-vs-2022-new-report-finds-disparities-in-hunger-and-funding/#:~:text=The%20number%20of%20undernourished%20people%20decreased%20by%2095%20million%20after,2009%2C%20when%20adjusted%20for%20inflation.>, (réf 31.03.2025).

Excellent
Super article, très clair et bien construit. J’ai trouvé la comparaison entre Irvine, Becker et Stankiewicz particulièrement éclairante, notamment sur les tensions entre rigueur doctrinale et mise en pratique contemporaine.
Cela dit, je suis un peu moins convaincu par l’idée que le stoïcisme serait en décalage avec notre époque. Entre le boom du self-help, la valorisation de la résilience ou certaines approches de la psychologie positive, on retrouve beaucoup d’éléments stoïciens recyclés, parfois jusqu’à l’indigestion. Du coup, le « climat intellectuel hostile » évoqué par Irvine me paraît un peu daté — voire un peu exagéré.
En te lisant, je me suis aussi demandé ce qu’Irvine aurait pensé d’une figure comme Tiruvalluvar, avec son Tirukkural. Bien sûr, on est loin d’Épictète ou Sénèque, mais sa conception de la vertu, de la maîtrise de soi et de l’impermanence du monde résonne assez clairement avec certains fondements stoïciens, même si elle s’ancre dans un cadre moral et poétique tamoul très différent. C’est toujours fascinant de voir comment des philosophies de vie similaires peuvent émerger en parallèle, avec des finalités propres.
(Bon, une certaine personne avait déjà tenté de citer Tiruvalluvar à une remise de diplômes à Genève, entre deux discours solennels… mais disons que dans ton cas, la réflexion tient un peu mieux la route 😅)
Hâte de lire la suite !