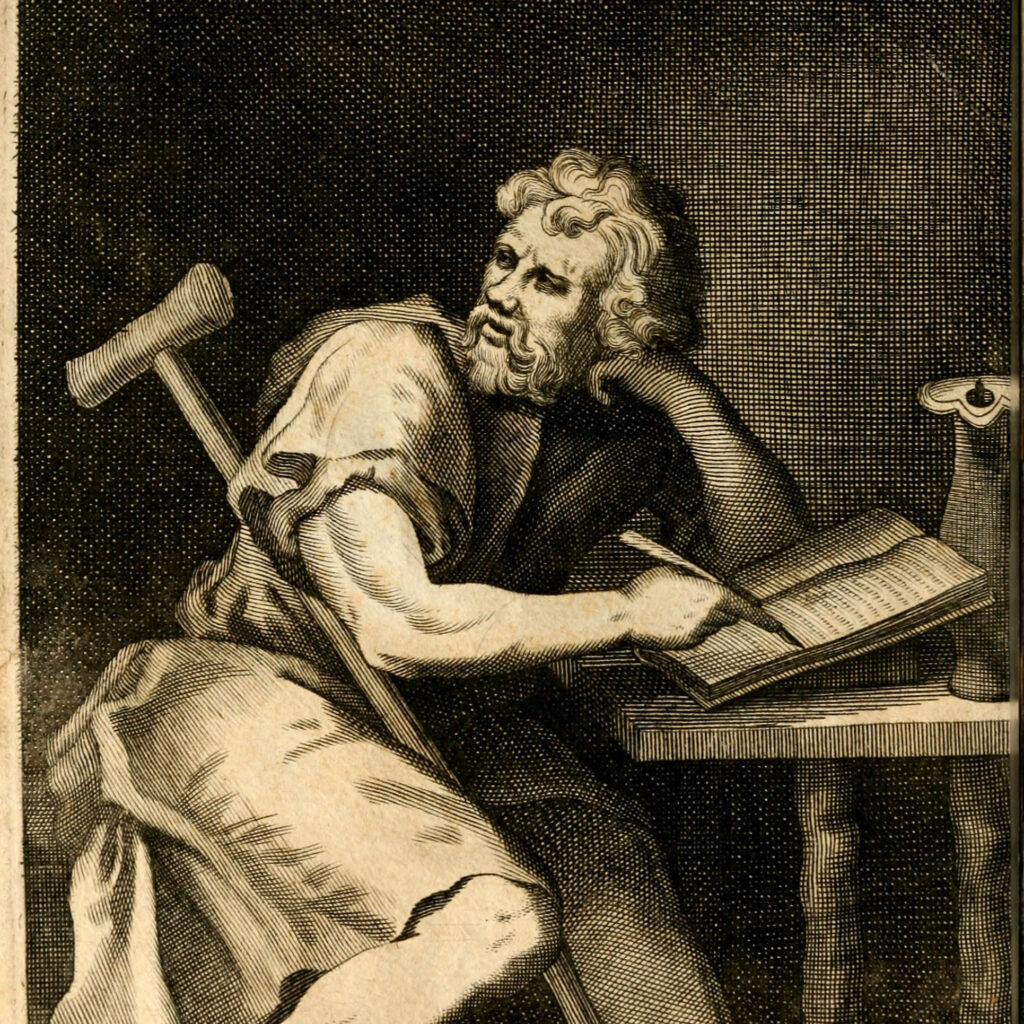
Le stoïcisme vise à former l’homme capable de vivre en accord avec la raison et la nature. La sagesse stoïcienne ne se limite donc pas à une connaissance théorique : elle s’exerce concrètement dans la vie quotidienne. Elle est une « philosophie pratique ». Pour ce faire, Épictète, célèbre philosophe stoïcien grec, né esclave à Hiérapolis en Phrygie et affranchi plus tard à Rome (il fut le maître à penser de l’empereur Marc Aurèle), propose une méthode précise pour atteindre cet idéal à travers ce qu’il appelle les trois « topoi » ou « lieux » de l’âme : le désir, l’impulsion et l’assentiment. Chacun de ces domaines correspond à un aspect fondamental de la vie humaine et nécessite un entraînement constant de la raison et de la volonté.
En effet, Épictète affirme que ces trois actes psychiques – « le désir », « l’impulsion » et « l’assentiment » – sont les trois domaines ou « lieux » (topoi) dans lesquels doit s’exercer celui qui veut devenir sage. Précisons qu’à chaque fois que cet « usage des représentations » est effectué, s’exerce également la faculté fondamentale de la « prohairesis », le « choix » en grec (il s’agit d’un concept introduit par Aristote qui lui sert à définir la Vertu). À l’inverse de Marc Aurèle, cette notion est importante chez Épictète, puisque tous les actes psychiques sont des actes prohairétiques. Il s’ensuit que les actes qui relèvent de notre choix s’identifient au « moi » pascalien — à l’ego cartésien — et sont, par essence, opposés aux « choses extérieures ». En d’autres termes, seule la prohairesis dépend de nous.
Ces trois lieux de l’exercice philosophique correspondent aux trois parties de la philosophie stoïcienne et s’imbriquent mutuellement entre elles. Ainsi, la discipline du désir correspond à la « physique », puisqu’elle « transforme le regard porté sur le monde[1] » ; celle des tendances correspond à « l’éthique », puisqu’elle « s’exerce à la justice dans l’action[2] » ; et enfin, celle de l’assentiment correspond à la « logique », puisqu’elle « produit la vigilance dans le jugement et la critique des représentations[3] ».
Ces trois parties couvrent donc tous les champs de la réalité. En effet, la première concerne la physique, car elle met en rapport l’homme avec le cosmos, la deuxième concerne l’éthique, puisqu’il s’agit du rapport de l’homme avec autrui, et enfin, la troisième concerne la logique, car elle traite du rapport de l’homme avec lui-même (sa faculté de penser).
Le désir ou l’aversion : l’amour de la Providence
Concernant la première discipline : « Elle se situe dans le désir et l’aversion, afin que tu ne manques pas ton but et ne tombes pas dans ce que tu redoutes[4] ». Ou encore « le lieu qui se rapporte aux désirs et aux aversions, afin de ne pas être frustré dans ses désirs et de ne pas tomber dans ce qu’on cherche à éviter[5] ».
Cette discipline se fonde sur la distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. Pour Épictète, il s’agit de la première discipline à travailler parce qu’elle concerne les passions, sources de troubles pour les hommes, et parce que ce sont de ces passions que dépend la « paix intérieure » (ou la tranquillité de l’âme). Ainsi, puisque ce topos se rapporte aux désirs et permet de purifier l’homme de ses passions, il s’agit du domaine le plus nécessaire.
Nous l’avons dit, « dépendent de nous nos actes libres, c’est-à-dire les trois fonctions de l’âme raisonnable : désir, tendance, assentiment. Ne dépendent pas de nous toutes les choses dont la réalisation échappe à notre liberté : la santé, la gloire, la richesse, tous les accidents qui supposent l’intervention de causes extérieures à nous[6] ». Sachant que nous n’avons aucune emprise sur ce qui ne dépend pas de nous, il est nécessaire de ne pas les « désirer », sans quoi nous nous heurterions à la torture du désir insatisfait. Pierre Hadot, philosophe français et spécialiste de la philosophie antique (et plus particulièrement du stoïcisme), établit un parallèle entre le premier thème et « tous les mots qui désignent une complaisance joyeuse et aimante[7] ». En d’autres termes, la discipline du désir doit nous apprendre à être dans une « disposition aimante », afin de vouloir que les évènements arrivent tels qu’ils arrivent, ceux-ci étant voulus par la Nature. C’est ce que Marc Aurèle énonce lorsqu’il affirme qu’« il faut aimer ce qui t’arrive pour deux raisons : l’une, c’est que l’évènement t’arrivait à toi, était ordonné pour toi, et avait rapport à toi, issu d’en haut et des causes suprêmes selon le fil du destin ; l’autre, c’est que ce qui advient à chacun en particulier est, pour celui qui gouverne l’univers, cause de réussite, de perfection et même, par Zeus, de conservation[8] ». La notion « d’amour » est primordiale, voire fondamentale, puisqu’elle déplace le concept « d’indifférence » dans un autre registre. « Être indifférent », n’est plus synonyme « d’impassibilité » ou de « désintérêt », mais au contraire d’amour pour tous les évènements qui surviennent, « sans différence » — puisque c’est ce que signifie originellement ce terme : « ne pas faire de différence ».
Afin d’atteindre cette disposition complaisante, il est nécessaire de percevoir la relation des évènements avec la Nature d’une part, et de reconnaître que tous ces évènements sont produits par un ensemble de causes nécessaires — causes premières — d’autre part, qui échappent à la connaissance humaine, mais qui permettent de replacer l’homme dans une perspective « cosmique », faisant lui-même partie de ce qui lui semble être un « enchevêtrement » causal. C’est pourquoi la discipline du désir devient une « physique ». Cette perspective cosmique « implique une contemplation sans cesse renouvelée » de toute « l’unité vivante du cosmos » et de « l’harmonie qui fait correspondre entre elles toutes choses[9] ». En d’autres termes, l’homme doit adopter une posture contemplative à l’égard de tout ce qu’engendre cette Nature. Ce faisant, tout ce qui lui paraissait auparavant « laid » lui apparaîtra dorénavant « beau ».
Dès lors, afin d’atteindre l’ataraxie (la tranquillité de l’âme), l’homme doit accepter avec joie tous les évènements qu’engendre la nature universelle. Marc Aurèle précise au livre X, pensée 11, qu’il faut acquérir une « méthode pour observer comment les choses se changent l’une en l’autre » : « Fais-y continuellement attention et exerce-toi de ce côté ; car rien n’est plus capable de produire les grandes pensées » (ce que l’on peut traduire par « grandeur d’âme »). Ainsi, cette « transformation du regard » qui s’opère par la pratique de l’épistémê (en l’occurrence par la connaissance du kósmos) est une vertu, celle-ci étant synonyme de « grandeur d’âme », ce que la tradition stoïcienne définit par : « la vertu ou le savoir qui nous élève au-dessus de ce qui peut arriver aussi bien aux bons qu’aux méchants[10] ».
L’impulsion ou son contraire la répulsion : l’amour d’autrui
Concernant la seconde discipline : « Elle se situe dans les tendances positives et négatives, afin que tu sois sans faute dans l’action[11]. » Ou encore « le lieu qui se rapporte aux tendances positives et négatives, en bref, celui qui se rapporte aux actions appropriées, afin d’agir de manière ordonnée, raisonnable, attentive[12] ».
Cette discipline se rapportant à l’action dans la communauté humaine, nous pouvons énumérer, sur la base du travail de Pierre Hadot[13], six préceptes des Pensées de Marc Aurèle qui traitent de celle-ci :
– Ne pas agir sans but : « n’accomplis aucun acte au hasard, ni autrement que ne le requiert la règle qui assure la perfection de l’art[14] ».
– Revenir aux principes raisonnables de l’action : « en moins de dix jours tu paraitras un dieu à ceux qui maintenant te regardent comme un fauve ou un singe, pourvu que tu reviennes aux principes et au culte de la raison[15] ».
– Agir justement sans s’occuper de ce que fait autrui : « que de loisirs il gagne celui qui ne regarde pas à ce qu’a dit le voisin, à ce qu’il a fait, à ce qu’il a pensé ; mais à ce qu’il fait lui-même, afin que son acte soit juste, saint et absolument bon[16] ».
– Retrancher ce qui n’est pas indispensable : « non seulement il faut supprimer les actions qui ne sont pas nécessaires, mais aussi les idées[17] ».
– Se représenter ce que l’on peut devenir si l’on ne contrôle pas ses tendances : « sombre caractère, caractère efféminé, sauvage, féroce, brutal, puéril, lâche, déloyal, bouffon, cupide, tyrannique[18] ».
– Comprendre les motifs des actions d’autrui : « examine avec attention leurs principes directeurs ; examine les sages, ce qu’ils évitent, et ce qu’ils recherchent[19] ».
Si le thème principal du premier topos est « l’amour » (ou au moins la bienveillance) à l’égard de l’Univers ou de la Providence, ici, il est ce que les stoïciens nomment « l’action appropriée » ou autrement traduit : « la fonction propre ». Celle-ci désignant toute action ou activité qui est conforme à la nature, on dit de cette action qu’elle est « convenable ». Usuellement, l’adjectif « droite » est utilisé pour définir l’action appropriée ; néanmoins, il s’agit d’une imprécision, car de facto, si toute action droite demeure une fonction propre, toute fonction propre n’est pas une action droite. C’est ce qui sépare le sophos (« sage ») du phaulos (« insensé »). En effet, dans la morale stoïcienne, il n’existe pas d’intermédiaire entre le sage, qui accomplit des actions nécessairement « droites », et les autres, les « insensés », qui accomplissent au mieux des actions « appropriées » à leur nature, mais non nécessairement droites (ou « accomplies ») au pire des actions « non appropriées ».
Ajoutons que, même si l’insensé tente de progresser sur le chemin de la sagesse, ses actes demeureront toujours des « péchés », puisqu’il lui manque la vertu. Ainsi, la distinction ne se fonde pas sur la « nature » de l’acte, mais sur sa « visée ». Le sage accomplit en toute circonstance une action en vue du bien, celle-ci est donc toujours vertueuse, alors que l’insensé est motivé par son impulsion première : le désir d’autoconservation.
Par conséquent, si le progressant est voué à rester « mauvais » ou « inférieur », pourquoi s’efforcerait-il de réaliser des actions droites ? En réalité, c’est à partir d’elles que le progrès est possible. C’est pourquoi la « parénèse » (l’exhortation à la vertu) est fondamentale chez les stoïciens. En effet, elle permet au progressant, à force de sélectionner les « préférables », d’atteindre la vertu.
L’assentiment : l’amour de la vérité
Concernant la troisième et dernière discipline : « Elle se situe dans l’assentiment et la suspension de l’assentiment, afin que tu ne sois pas dans l’erreur[20] ». Ou encore « le troisième est celui qui se rapporte à l’absence d’erreur et de légèreté, en un mot, aux assentiments[21] ».
« L’assentiment » est synonyme de « jugement » en ce sens que celui-ci désigne la faculté d’entendement (« l’acte psychique »), par laquelle nous donnons notre adhésion à une représentation (qui s’impose à nous ou non) que l’on reconnaît pour vraie. Une « représentation » désignant « l’affection de l’âme » ou « l’empreinte dans l’âme » ou encore « l’altération de l’âme », qui, comme la lumière, « se révèle elle-même en même temps que ce qui l’a produite[22] ». Pour le dire autrement, l’assentiment désigne la capacité de la prohairesis (faculté rationnelle qui distingue l’homme du reste des animaux[23]) à juger du critère de vérité des impressions ou des représentations.
De surcroît, lorsque nous donnons notre assentiment à une chose « probable », celui-ci est appelé « opinion » (puisqu’il s’agit d’une croyance). Ajoutons que cet assentiment repose sur un acte « volontaire », ce qui fait de l’homme le seul responsable de sa « folie », si celui-ci est amené à juger une chose fausse comme vraie. En conséquence, il est facile de comprendre que, pour le progressant, discipliner son assentiment est primordial, celui-ci étant au fondement de la science (ou de « savoir connaître », une qualité propre au sage). Le sage « détient la vérité », alors que l’insensé peut « dire le vrai ». La nuance se situe dans « l’état de l’âme », ferme et inébranlable chez le sage, de telle sorte qu’aucune chose ne peut s’opposer à sa compréhension ; faible voire atonique chez l’insensé, qui le conduit à donner son assentiment à des impressions dites « non cataleptiques ». Une « représentation cataleptique » renvoie, comme le rapporte le philosophe sceptique Sextus Empiricus[24], à un type de représentations nommées « persuasives », faisant elles-mêmes partie de la catégorie des « représentations vraies ». Elle se définit comme suit : « une impression cognitive [ou cataleptique] est une impression qui provient de ce qui est, et qui est scellée et imprimée en conformité exacte avec ce qui est, telle qu’elle ne saurait provenir de ce qui n’est pas ». En d’autres termes, celle-ci est intrinsèquement vraie, car elle est évidente en elle-même. « Elle saisit ainsi à la fois le sujet pour le mener à l’assentiment, et l’objet, dont elle peut donner toutes les caractéristiques, puisqu’elle lui est parfaitement conforme[25] ». C’est pourquoi la représentation cataleptique est aussi appelée « compréhensive », « perceptive » ou encore « cognitive ».
Le progressant doit donc s’attacher à travailler son « amour » pour la vérité, comme il le fait dans la première discipline avec la nature universelle, et dans la deuxième discipline avec les autres hommes. Ce triple « exercice » (ou « pratique », du grec askêsis qui donnera le mot « ascèse »)lui permettra schématiquement de « bien désirer » — ordre du sentiment —, de « bien agir » — ordre de l’action —, et de « bien penser » — ordre de la raison. En effet, rappelons-le : « ce qui trouble les hommes ; ce ne sont pas les choses, mais les jugements relatifs aux choses[26] ».
[1] Pierre Hadot, « Une clé des pensées de Marc Aurèle : les trois topoi philosophiques selon Épictète », Les Études Philosophiques. no. 1, 1978, p.70. URL : http://www.jstor.org/stable/20847455.
[2] Id,.
[3] Id,.
[4] Épictète, Les Entretiens. I, 4, 11, trad. J. Souilhé.
[5] Ibid., III, 2, 1.
[6] Pierre Hadot, « Une clé des pensées de Marc Aurèle : les trois topoi philosophiques selon Épictète », art. cit., p.72.
[7] Ibid., p. 73. Cf. Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, III, 4, 4 ; III, 16, 3 ; IV, 25 ; V, 8, 10 ; V, 27 ; VII, 54 ; VIII, 7, 1 ; IX, 3, 1 ; IX, 6 ; X, 6, 4 et 6.
[8] Id,.V, 8.
[9] Pierre Hadot, « Une clé des pensées de Marc Aurèle : les trois topoi philosophiques selon Épictète », art. cit., p.74.
[10] « Stoic. Veter. Fragm., t. III, § 264. Sur la notion stoïcienne d’« indifférents », cf. Stoic. Veter. Fragm., t. I, § 47 ; t. III, § 70-71 et 117. Sur les origines et la signification de cette notion, cf. O. Luschnat, « Das Problem des ethischen Fortschritts », dans Philologus, t. CII, 1958, pp. 178-214 ».
[11] Épictète, Les Entretiens, I, 4, 11.
[12] Ibid., III, 2, 1.
[13] Pierre Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique, « les trois topoi, clé des pensées de Marc Aurèle ». 2002, p. 129.
[14] Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, Livre IV, 2.
[15] Ibid., IV, 16.
[16] Ibid., IV, 18.
[17] Ibid., IV, 24.
[18] Marc Aurèle, Pensées pour moi-même, Livre IV, 28.
[19] Ibid., IV, 38.
[20] Épictète, Les Entretiens, Livre I, 4, 11.
[21] Ibid., III, 2, 1.
[22] Long et Sedley, Les philosophes hellénistiques. trad. Brunschwig et Pellegrin, G.F, 39B.
[23] Épictète, Les Entretiens, Livre I, 6.
[24] Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos. VII, 248.
[25] Valéry Laurand, Le vocabulaire des stoïciens, Paris, Ellipses, 2022, p.56.
[26] Épictète, Le Manuel, 5, trad. J. Souilhé.

Merci beaucoup pour cet article très instructif 🙂