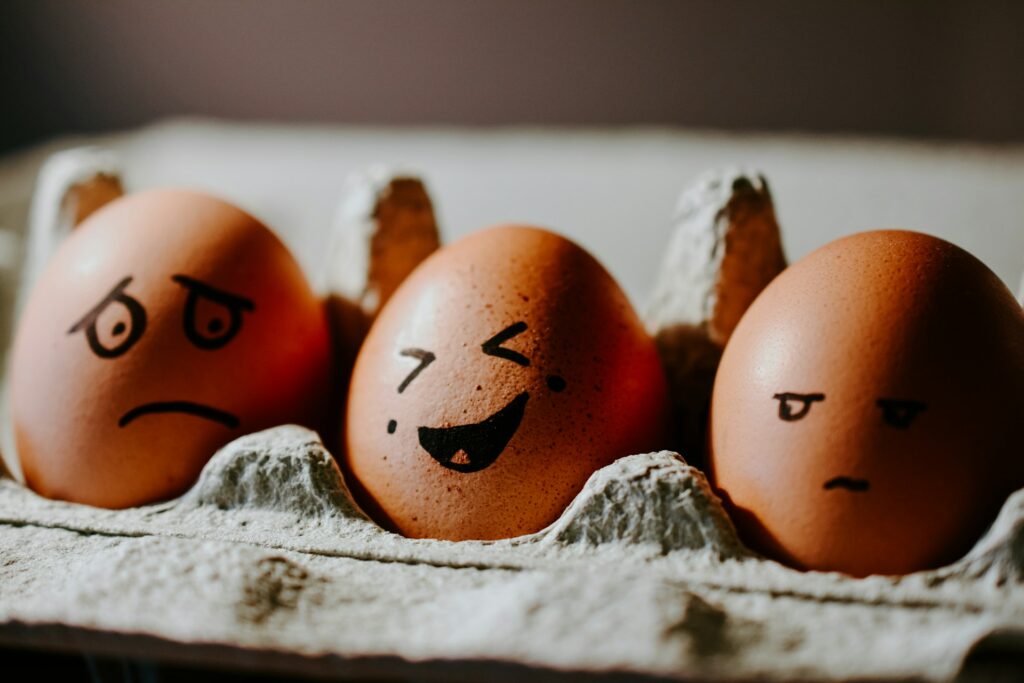
This is a translated version of an English-language article that originally appeared on Philosophy Break, written by Jack Maden. The original article is here: Stoicism and Emotion: Don’t Repress Your Feelings, Reframe Them
Le texte qui suit est la traduction française d’un article de Jack Maden intitulé “Stoicism and emotion: don’t repress your feelings, reframe them”, publié sur son blog personnel Philosophy Break. Traduction française de Véronique Falzon, relue par Maël Goarzin. Nous remercions l’auteur de cet article de nous avoir donné l’autorisation de publier la traduction de ce texte. L’article original peut être lu ici: « Stoicism and emotion: don’t repress your feelings, reframe them« .
Stoïcisme et émotion : ne refoulez pas vos sentiments, reformulez-les
Par Jack Maden
Malgré l’usage moderne du mot « stoïque », le stoïcisme ne nous dit pas de refouler nos sentiments ; il nous invite plutôt à exercer notre jugement pour les accepter et les reformuler.
Lorsque nous sommes sous l’emprise d’une émotion destructrice, aussi appelée passion[1] — la colère, par exemple — il n’existe pas d’échappatoire immédiate. L’émotion nous submerge, et tout ce que nous pouvons faire, c’est attendre qu’elle se dissipe.
Les philosophes stoïciens de la Grèce et de la Rome antiques connaissaient bien cette réalité. Dans son remarquable traité De la colère, Sénèque décrit la colère comme une folie passagère :
« Comme celle-ci en effet elle ne sait pas se maîtriser, perd la notion des convenances, oublie tous les liens sociaux, s’acharne et s’obstine dans ses entreprises, ferme l’oreille aux conseils de la raison, s’agite pour des causes futiles, incapable de discerner le juste et le vrai et semblable aux ruines qui se brisent sur ce qu’elles écrasent. » (Sénèque, La colère, I, 2, trad. A. Bourgery, revue par P. Veyne)
Étant donné qu’ils perçoivent les émotions telles que la colère comme destructrices, il n’est pas étonnant que les stoïciens aient acquis la réputation de chercher à les réprimer.
Cependant, bien qu’on considère souvent le stoïcisme comme une philosophie qui nous incite à refouler nos sentiments ou émotions — serre les dents ! garde ton flegme ! — la conception stoïcienne apporte une nuance subtile mais essentielle.
La recommandation stoïcienne n’est pas de réprimer nos émotions, mais simplement de ne pas les laisser surgir.
Cela peut sembler une recommandation étrange. Nous sommes humains : comment pourrions-nous ne pas ressentir d’émotions ?
Comment les stoïciens définissent la passion
Tout repose sur la manière dont les stoïciens définissent la passion (ou émotion destructrice). Nous faisons tous l’expérience de ce que Sénèque appelle les « premiers mouvements involontaires » en réaction à certains événements.
Nous pouvons nous sentir choqués, excités, euphoriques, effrayés. Ce sont là des réactions physiologiques naturelles qui nous arrivent spontanément, sur lesquelles nous n’avons aucun contrôle.
Mais, point essentiel : pour les stoïciens, ce ne sont pas des émotions destructrices (ou passions). Ce sont des réactions initiales, des « premiers mouvements involontaires ».
C’est lorsque nous faisons un mauvais jugement et que nous laissons ces premiers mouvements nous entraîner que les émotions destructrices (ou passions) se manifestent.
Il y a donc trois étapes dans la production des émotions :
- Premier mouvement involontaire
- Jugement
- Émotion destructrice (ou passion)
Nous n’avons aucun contrôle sur la première étape, pas plus que sur la troisième dès lors que nous y parvenons.
L’étape cruciale est donc la deuxième : le jugement. Nous pouvons utiliser notre capacité de jugement soit pour arrêter un premier mouvement dans son élan, soit pour laisser nos réactions initiales prendre de l’ampleur et se transformer en émotions destructrices et incontrôlables.
Par exemple, si nous réagissons d’abord avec effroi et peur à la vue d’une araignée, mais que nous jugeons ensuite que, même s’il est parfaitement naturel de sursauter au départ, ce n’est en réalité qu’une toute petite araignée inoffensive, et que nous allons chercher un verre pour la capturer et la relâcher dehors — tout en respirant profondément pour nous calmer — alors nous aurons réussi à ralentir la libération d’adrénaline dans notre corps et à stopper un « premier mouvement involontaire » dans son élan (tout en faisant preuve de la vertu cardinale stoïcienne de courage — bravo à nous).
En revanche, si nous jugeons que la peur est justifiée, voire insuffisante — « mon Dieu, une araignée ! Je déteste ça, qu’est-ce que je vais faire ? Je suis vraiment en danger » — alors le « premier mouvement » prend de l’ampleur : notre mauvais jugement intensifie nos réactions physiologiques, qui se transforment en une véritable émotion de peur, et il ne nous reste plus qu’à attendre que l’émotion destructrice passe, tout en agissant, entre-temps, de manière irrationnelle et incontrôlable.
Ainsi, le conseil stoïcien n’est pas d’éviter les « premiers mouvements » — ce serait impossible. Le conseil est de travailler notre jugement afin d’éviter que ces premiers mouvements ne se transforment en émotions destructrices (ou passions).
Avoir peur, être nerveux, agacé : cela fait partie de la condition humaine.
L’idée, c’est d’employer notre jugement pour accueillir ces ressentis et impulsions naturels, puis de nous rappeler avec bienveillance que nous n’avons pas à les laisser altérer notre perception du monde, envahir nos pensées ou diriger nos actions (en effet, les seules choses qui devraient guider nos actions sont les quatre vertus cardinales du stoïcisme : la sagesse, le courage, la justice et la tempéran
Il est tout à fait normal d’être agacé de temps en temps, c’est parfaitement naturel. Cela devient un problème si nous laissons régulièrement nos agacements se transformer en colère incontrôlable.
Pour les stoïciens, « maîtriser ses émotions » signifie non pas les réprimer ou les nier, mais utiliser son jugement pour les remettre en perspective avec sagesse, et ainsi éviter de perdre le contrôle.
Et, point important, le but de cette maîtrise n’est pas seulement de nous procurer du soulagement ; c’est surtout de nous permettre d’avancer de manière constructive, et de faire ce qui est juste.
Comme l’écrit Sénèque :
« La passion consiste non pas à être ému par l’idée que fait naître un objet, mais à s’y abandonner et à suivre ce mouvement fortuit. S’imaginer que la pâleur, les larmes, l’excitation génitale, un profond soupir, l’éclat soudain des yeux ou tout autre phénomène analogue soit l’indice d’une passion et la manifestation de notre état d’esprit, c’est tomber dans l’erreur et méconnaître qu’il s’agit là d’impulsions purement corporelles. (…) Quelqu’un se croit lésé, il veut se venger, un motif quelconque l’en dissuade et il y renonce : j’appelle cela non de la colère, mais un mouvement de l’esprit qui obéit à la raison ; la colère, c’est ce qui outrepasse la raison, qui l’entraîne avec soi. » (Sénèque, La colère, II, 3, 1-4)
Mettre en pratique l’approche stoïcienne des émotions dans la vie quotidienne
Bien sûr, les stoïciens écrivaient à une époque où les fondements physiologiques de troubles comme l’anxiété chronique n’avaient pas encore été étudiés ni compris. Leurs conseils — utilise ton jugement pour prendre du recul sur ta situation ! — ne sont donc pas nécessairement suffisants dans tous les cas, et ne remplacent en rien un accompagnement thérapeutique professionnel.
Néanmoins, se rappeler les enseignements du stoïcisme peut apporter un réel bénéfice : en essayant de porter un jugement plus clair sur une situation, nous pouvons nous protéger de l’escalade vers des émotions destructrices, et ouvrir un espace pour avancer avec vertu.
Par exemple, imaginons que quelqu’un vous insulte. Sur le moment, vous pourriez juger que c’est scandaleux qu’une personne vous offense ainsi, et votre « premier mouvement » d’agacement pourrait vite se transformer en colère.
L’erreur ici, comme le souligne le philosophe stoïcien Épictète, c’est de penser que parce que vous avez été insulté, vous avez forcément été blessé :
« Souviens-toi que celui qui t’outrage n’est pas celui qui insulte ou qui frappe, mais l’opinion que ces choses sont outrageantes. Par conséquent, lorsque quelqu’un t’irrite, sache que c’est ton jugement qui t’a irrité. » (Épictète, Manuel, 20, trad. O. D’Jeranian)
Vous n’êtes blessé, dit Épictète, que si vous choisissez de décider que vous l’êtes. Comme le précise le philosophe contemporain John Sellars dans son petit livre aussi concis qu’éclairant, Lessons in Stoicism (qui figure dans notre sélection des meilleurs ouvrages sur le stoïcisme) :
« Si quelqu’un formule une critique à votre égard, prenez un moment pour vous demander si ce qu’il dit est vrai ou faux. Si c’est vrai, alors cette personne vous a signalé un défaut que vous pouvez désormais corriger. En ce sens, elle vous a rendu service. Si ce qu’elle dit est faux, alors elle se trompe, et la seule personne à se nuire, c’est elle-même. Dans les deux cas, ses propos critiques ne vous font subir aucun tort. »
La leçon ici est la suivante : nous ne devrions pas laisser nos réactions impulsives guider notre comportement.
Si nous le faisons, ce n’est pas simplement un manque de discernement, c’est une absence totale de jugement : nous passons directement du « premier mouvement » à l’émotion destructrice (ou passion), sans appliquer la moindre once de raison pour tempérer la situation.
Nous devons donc veiller à prendre le temps de faire une pause et de réfléchir avant de passer à l’action.
Il nous faut accueillir nos ressentis tels qu’ils se présentent, faire le point, rappeler à notre esprit les vertus, puis agir.
Sénèque l’exprime très bien lorsqu’il dit : « Le grand remède de la colère, c’est l’ajournement » (La colère, II, 29, 1), et encore : « Il faut se donner un délai ; le temps fait éclater la vérité » (La colère, II, 22, 3)
Alors : faites une pause, et souvenez-vous de cette phrase de Marc Aurèle, sans doute le plus célèbre des philosophes stoïciens (voir notre sélection des meilleurs livres de Marc Aurèle) :
« Quand tu es affligé par une chose extérieure, ce n’est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Et ce jugement, il dépend de toi de le supprimer immédiatement. » (Marc Aurèle, Pensées, trad. M. Goarzin)
Et si nous ne parvenons pas à arrêter nos émotions ?
Et si attendre ne suffit pas à apaiser l’intensité de ce que nous ressentons ? Qu’en est-il des cas d’injustice flagrante ou de tort infligé à un proche ? Que faire lorsque la force de nos émotions menace de submerger les jugements raisonnés que nous tentons d’y opposer, et risque de nous faire basculer dans une émotion incontrôlable ?
La tactique stoïcienne recommandée dans ce cas — si nous sommes tout simplement incapables de rationaliser l’élan de colère d’un premier mouvement — consiste à utiliser notre faculté de jugement pour rediriger la force de nos émotions vers quelque chose de constructif.
Ainsi, face à une injustice subie par un être cher, il s’agit de rassembler ce « premier mouvement » de passion non pas sous la bannière de la colère, mais sous celle de la justice. Laissez vos émotions être guidées par la vertu, et non par un vice incontrôlé.
De cette manière, la destructivité des émotions négatives est moins susceptible de vous ronger, car vous agissez avec une intention constructive.
Efforcez-vous d’agir avec calme et résolution pour faire ce qui est juste, plutôt que de vous perdre dans une rage destructrice.
En résumé, donc, les stoïciens cherchent à nous aider à gérer les émotions destructrices en rappelant la leçon essentielle de la dichotomie du contrôle : concentrons-nous sur ce qui dépend de nous.
Nous ne pouvons pas contrôler nos réactions initiales face à certaines situations, mais nous pouvons contrôler le jugement que nous portons sur ces « premiers mouvements ».
En nous entraînant à faire une pause, réfléchir et juger de façon constructive, nous pouvons — avec de la pratique — empêcher ces premiers mouvements de prendre de l’ampleur, et ainsi nous libérer des émotions négatives et incontrôlables qui ont le pouvoir de gâcher notre vie.
Comment les stoïciens abordent-ils les émotions positives ?
Qu’en est-il des émotions positives comme l’amour ? Les stoïciens pensent-ils que nous devrions aussi les rationaliser et les modérer ? Le verdict ici est généralement que les stoïciens s’inquiètent des émotions qui risquent de compromettre la tranquillité de notre vie.
Un amour jaloux et possessif, par exemple, a le potentiel de détruire une vie, et doit donc être traité comme n’importe quelle autre émotion négative. Mais un amour compatissant, fondé sur notre besoin naturel de lien et de compagnie, est parfaitement sain — à condition que nous restions vigilants à ne pas y projeter d’attentes irréalistes ou de croyances erronées susceptibles de nous briser plus tard.
Par exemple, si nous croyons à tort que l’amour entre nous et un parent, un partenaire ou nos enfants durera éternellement, alors — étant donné que nous sommes tous mortels — nous risquons de recevoir un rude choc.
Ainsi, il ne s’agit pas de réprimer ni de modérer les élans de joie spontanés, mais d’être attentifs à ce qu’ils ne se transforment pas en faux espoirs ou en illusions sur ce que l’avenir pourrait réserver.
[1] Ndlr : dans cet article, l’auteur utilise le terme d’émotion pour décrire les émotions destructrices, désignées généralement par le terme de « passions ». Pour plus de clarté, nous avons donc précisé la pensée de l’auteur en employant également le terme de passion. Sur la thérapeutique stoïcienne des passions, qui vise à se libérer des passions par un travail sur nos représentations, voir l’article de Maël Goarzin : https://stoagallica.fr/de-lapathie-des-stoiciens-absence-demotions-ou-liberation-des-passions/
