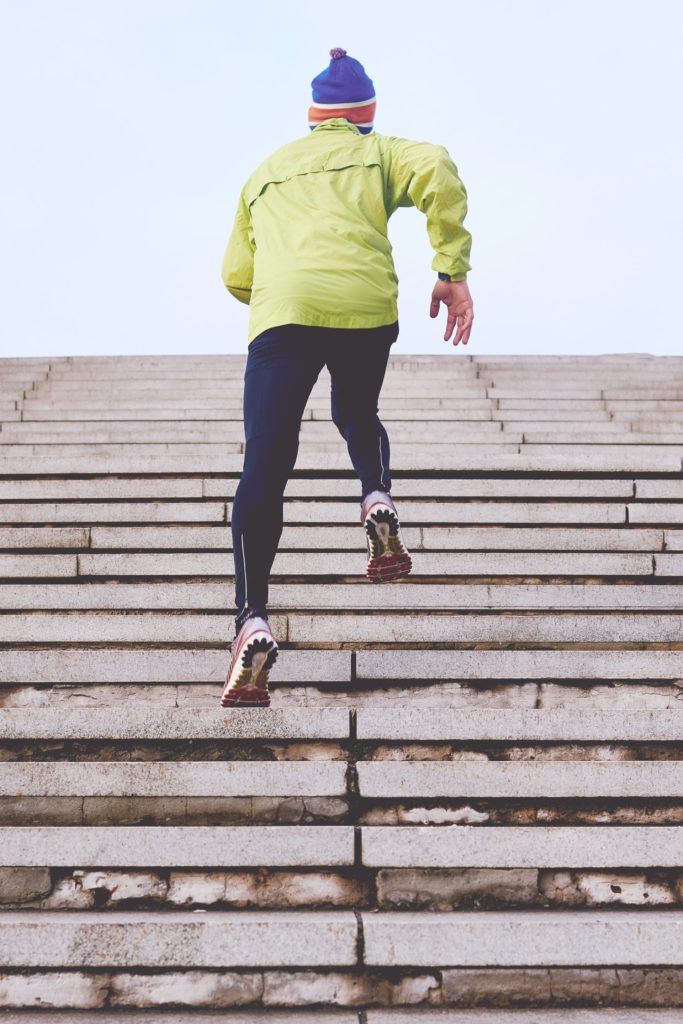
Marc Aurèle fait mention du couple « peine et plaisir » à plusieurs reprises dans ses Pensées (Livre II, 11 ; 12 ; 16 ; Livre III, 3 ; Livre V, 31 ; Livre VIII, 8 ; 14 ; 41 ; Livre IX, 1 ; Livre XII, 8 ; 34), et également dans celle ci-dessous :
« Mais ce qui intéresse ton corps aura encore prise sur toi ? Considère que l’intelligence ne se mêle pas aux agitations, ou douces ou violentes, du souffle, une fois qu’elle s’est reprise et qu’elle a reconnu son pouvoir, et enfin tout ce qu’on t’a enseigné sur la peine et le plaisir, à quoi tu as donné ton assentiment. »
Marc Aurèle, Pensées, Livre IV, 3, 3. (trad. A.-I. Trannoy modifiée [1])
Mais qu’est-ce qui a bien pu être enseigné à Marc Aurèle au sujet de la peine et du plaisir ? Et à quoi a-t-il bien pu donner son assentiment sur ce sujet ?
Nous allons essayer de répondre à ces questions dans la suite de cet article, en mettant en exergue l’articulation essentielle entre logique et éthique dans le système stoïcien.
L’enseignement de Musonius Rufus
On peut trouver un début de réponse aux questions précédentes dans l’un des Entretiens qui nous a été préservé de Musonius Rufus :
« Par exemple, que le plaisir n’est pas un bien, voilà qui n’est pas directement connu (γνώριμον), puisqu’en fait le plaisir nous appelle comme s’il était un bien. Mais en prenant comme prémisse connue (λῆμμα γνώριμον) que tout bien est à choisir (τὸ πᾶν ἀγαθὸν αἱρετὸν εἶναι) et en prenant cette autre prémisse que quelques plaisirs ne sont pas à choisir (τινὰς ἡδονὰς οὐχ αἱρετὰς εἶναι), nous démontrons que le plaisir n’est pas un bien, le non-connu par le connu (διὰ τῶν γνωρίμων τὸ μὴ γνώριμον). À nouveau, que la peine ne soit pas un mal, voilà qui n’apparaît pas directement vraisemblable (πιθανόν) – c’est en effet le contraire qui paraît plus vraisemblable (πιθανώτερον), que la peine est un mal. Si nous posons la prémisse évidente que tout mal est à fuir (πᾶν τὸ κακὸν φευκτὸν εἶναι) et si nous lui ajoutons cette autre plus évidente (φανε-ρωτέρου) que beaucoup de peines ne sont pas à fuir (πόνους πολλοὺς οὐκ εἶναι φευκτούς), il se conclut que la peine n’est pas un mal. »
Musonius Rufus, Entretien, I, 9-22
Valéry Laurand, dans son ouvrage Stoïcisme et lien social, analyse ce passage dans les pages 84 à 86, et soulève l’importance des démonstrations logiques apportées par Musonius Rufus pour arriver à un jugement correct permettant par la suite d’agir de manière appropriée :
« Tels sont les deux arguments qui pourraient passer pour les éléments fondamentaux de l’enseignement de Musonius. On doit rejeter des apparences trompeuses, issues de la corruption de l’enfance, admises sans réel examen et vivre en conformité avec la réalité qu’est capable de montrer la démonstration. […] La difficulté des deux conclusions, le fait que ni l’une ni l’autre ne soit directement évidente vient bien sûr de ce que l’insensé n’a pas accès à cette vie selon la raison que la démonstration à la fois lui rend manifeste et lui propose. […] C’est que le jugement, une fois affermi et capable de choisir le bien, peut par là même éviter consciemment le mal. Ces distinctions sont très intriquées dans le raisonnement de Musonius et on ne les détecte qu’en étant attentif au fait qu’il procède par deux démonstrations qui n’ont pas tout à fait la même valeur démonstrative, puisque l’on passe de gnôrimon (connu) à pithanon (persuasif). Il s’agit pour Musonius (et l’énoncé des conclusions, par sa forme négative : « le plaisir n’est pas un bien », « la peine n’est pas un mal » le montre) de revenir aux racines mêmes de la diastrophê, pour extirper tout jugement défectueux. »
Nous allons étudier dans la suite de cet article ces deux démonstrations et commenter ce qu’en dit Valéry Laurand dans la suite de son ouvrage. Mais intéressons-nous d’abord à ce qui est l’objet de la discipline de l’assentiment, à savoir de corriger tout jugement défectueux, et comment elle repose, comme le dit Épictète, sur la possession de prénotions claires et bien appliquées :
« Contre l’apparence de vérité produite par les objets, il faut avoir des prénotions claires, nettes et prêtes à être appliquées. »
Épictète, Entretiens, Livre I, 27, 6. (trad. R. Muller)
Sur les prénotions
Chrysippe est le premier stoïcien connu à utiliser ce terme de prénotion, et est probablement celui qui l’a introduit dans le Stoïcisme après l’avoir tiré des Épicuriens.
« Par prénotion les épicuriens entendent une sorte de conception, une notion vraie, une opinion, une idée générale qui subsiste en nous, en d’autres termes le souvenir d’un objet extérieur, souvent perçu antérieurement ; telle est cette idée : L’homme est un être de cette nature. En même temps que nous prononçons le mot homme, nous concevons immédiatement le type de l’homme, en vertu d’une prénotion que nous devons aux données antérieures des sens. La notion première que réveille en nous chaque mot est donc vraie ; en effet nous ne pourrions pas chercher une chose, si nous n’en avions préalablement l’idée. »
Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, X, 33. (trad. R. Goulet)
La prénotion est listée par Chrysippe comme un des critères de vérité :
« Ils affirment que le critère de la vérité est la représentation compréhensive […] Mais Chrysippe, se contredisant lui-même, affirme, au premier livre de son traité Sur la raison, que les critères sont la sensation et la prénotion ; or la prénotion est une notion naturelle des universaux. »
Diogène Laërce, Vie et doctrine des philosophes illustres, VII, 54
La représentation compréhensive est le critère de vérité le plus souvent mentionné par les stoïciens, mais ils auraient également assigné ce rôle à la sensation et la prénotion. Ces critères ne sont pas en contradiction, car la sensation, la représentation compréhensive et la prénotion sont intimement liées. En effet, la sensation claire engendre les représentations compréhensives, qui, par accumulation dans notre mémoire, engendrent une prénotion. Cette réaction en chaîne, ayant la sensation pour point de départ, constitue alors différents niveaux du critère de vérité.
Le critère de vérité est plus spécifiquement la prénotion qui oriente la discipline de l’assentiment. L’assentiment correspond en effet à l’acte de juger le vrai, le faux et l’incertain, causé par ce qui paraît exister, c’est-à-dire par le sentiment du vrai. Les prénotions sont développées au travers d’une tendance naturelle de l’individu à assentir à certaines choses comme étant vraies.
Épictète considère les mouvements naturels du désir et de l’impulsion comme les pendants pratiques de ceux de l’assentiment, l’attirance vers le bien et la répugnance du mal, d’une part, et l’inclination vers le juste et le beau (le convenable) et l’aversion pour l’injuste et le laid (le non convenable), d’autre part, correspondant à l’adhésion au vrai et le refus du faux. Ainsi, les prénotions imprègnent de cette manière aussi les autres disciplines.
« Pour l’être vivant doué de raison, seul ce qui est contraire à la raison est insupportable ; ce qui est raisonnable, par contre, peut être supporté. […] Bref, si nous y regardons avec attention, nous trouverons que rien n’accable autant l’être vivant en question que ce qui est contraire à la raison, et inversement que rien ne l’attire autant que ce qui est raisonnable. Cependant, ce qui est raisonnable et ce qui est contraire à la raison se présentent différemment aux yeux de chacun, tout comme le bien et le mal, l’utile et le nuisible diffèrent selon les individus. C’est précisément pour cela que nous avons besoin d’éducation, pour apprendre à appliquer aux cas particuliers, conformément à la nature, les prénotions de ce qui est raisonnable et de ce qui est contraire à la raison. »
Épictète, Entretiens, Livre I, 2, 1-6
En tant qu’êtres rationnels nous possédons des prénotions universellement partagées. Tout le monde saisit ce que cela veut dire que quelque chose soit nuisible ou mauvais pour eux. En effet, que quelque chose soit nuisible signifie qu’il devrait être évité et que nous devrions chercher à nous en débarrasser.
« Les prénotions sont communes à tous les hommes ; et aucune prénotion n’est en conflit avec une autre. Qui d’entre nous, en effet, ne reconnaît pas que le bien est utile, qu’il est digne d’être choisi, qu’il faut le rechercher et le poursuivre en toute circonstance ? Qui d’entre nous ne reconnaît pas que ce qui est juste est beau et convenable ? Quand donc naît le conflit ? Dans l’application des prénotions aux réalités particulières, quand par exemple l’un dit : « Il a bien agi, c’est un homme courageux », et l’autre : « Non, il a perdu la raison ! » De là vient que les hommes sont en conflit les uns avec les autres. »
Épictète, Entretiens, Livre I, 22, 1-3
Les humains ne diffèrent en fait pas dans leurs prénotions, puisqu’elles sont communes à tous les hommes selon Épictète, mais selon comment ils les appliquent à des situations particulières.
Sur l’application des prénotions
Si, comme l’affirment les stoïciens, le mal se résume à la faute morale, et si cette faute implique toujours une contradiction dont l’âme ne s’aperçoit généralement pas, le conflit psychologique tient à l’application des prénotions plutôt qu’aux prénotions elles-mêmes. Épictète dit en effet que l’application incorrecte des prénotions est la cause de tous les maux humains :
« C’est cela, en effet, la cause de tous les maux pour les hommes : être incapable d’appliquer les prénotions communes aux cas particuliers. »
Épictète, Entretiens, Livre IV, 1, 42
Tout désir et toute aversion a pour unique cause un jugement. La reconnaissance d’une certaine valeur entraîne ensuite une impulsion adaptée de l’agent. Autrement dit, bien que nous n’ayons pas le choix de poursuivre ou non un bien apparent, ni de fuir ou non un mal apparent, puisque cela nous est naturel, nous sommes néanmoins responsables dans la mesure où ceci est déterminé par le libre usage de nos représentations dans l’application des prénotions.
« De même que toute âme est naturellement portée à donner son approbation au vrai, à la refuser au faux et à la suspendre si ce n’est pas clair, de même elle est naturellement mue par le désir du bien, par l’aversion pour le mal, et n’est sujette à aucun de ces deux mouvements en présence de ce qui n’est ni mal ni bien. »
Épictète, Entretiens, Livre III, 3, 2
C’est par l’expérience de l’échec du désir, et de la passion négative qui en découle, que nous savons, non pas que le bien n’existe pas par nature, mais plutôt que nous en avons mal appliqué la prénotion, comme le dit Épictète ci-dessous :
« Si tu appliques convenablement tes prénotions, pourquoi n’es-tu pas serein, pourquoi es-tu entravé ? Laissons pour le moment le deuxième thème, celui qui concerne les propensions et l’art de déterminer le devoir qui s’y rapporte. Laissons également de côté le troisième, celui qui a pour objet les assentiments. Je te fais grâce de tout cela. Tenons-nous en au premier, qui nous fournit la preuve tangible, pour ainsi dire, que tu n’appliques pas convenablement tes prénotions. Est-ce qu’actuellement tu veux ce qui est possible, et ce qui est possible à toi ? Dans ce cas, pourquoi es-tu entravé ? Pourquoi n’es-tu pas serein ? N’es-tu pas en train de fuir l’inévitable ? Pourquoi alors tombes-tu sur une chose que tu veux éviter, pourquoi es-tu malheureux ? Pourquoi ce que tu veux n’arrive-t-il pas ? Pourquoi ce que tu ne veux pas arrive-t-il ? »
Épictète, Entretiens, Livre II, 17, 14-18
Le jugement portant sur l’action à accomplir, à savoir l’impulsion, fait usage de la prénotion du devoir, dont l’application aux cas particuliers devra également faire l’objet d’un examen afin d’éviter d’être entraîné par une représentation, et donc conséquemment à commettre une action contraire à la Nature. Agir droitement ne peut donc être assuré que suite à un jugement correct sur le convenable (Épictète, Entretiens, Livre I, 11, 35-37).
La prénotion du devoir, c’est-à-dire « ce que l’on doit accomplir » ne contient pas la règle de son application aux cas particuliers, et pour cette raison elle ne peut être évaluée que sur la base de nos « relations naturelles et acquises » (Épictète, Manuel, 30, 1), et plus particulièrement par l’examen de ces noms qui nous indiquent nos différents rôles (Épictète, Entretiens, Livre II, 10, 1-11), mais aussi à partir de la notion d’homme, cet « animal doux et sociable » (Épictète, Entretiens, Livre II, 10, 14 ; II, 20, 13). Ce n’est qu’une fois le bien et le mal situés dans la faculté de choix (prohairesis) et que le principe directeur aura été sauvegardé, que la préservation conforme à la Nature de ces relations naturelles pourra être réalisée et devenir un bien.
« Quelle est la première tâche de celui qui pratique la philosophie ? Rejeter ce qu’il croit savoir ; car il est impossible qu’on se mette à apprendre ce qu’on croit savoir. […] Ce qui trompe beaucoup de gens, c’est précisément ce qui trompe le rhéteur Théopompe quand il reproche à Platon de vouloir tout définir. Que dit-il, en effet ? « Avant toi, aucun de nous ne parlait de ‘‘bon’’ ou de ‘‘juste’’ ? Est-ce que par hasard nous n’avions pas une claire conscience de ce que sont le bon et le juste, et que nous émettions des sons indistincts, vides de sens ? » Qui te dit, Théopompe, que nous n’avions pas de chacune de ces choses des notions naturelles, c’est-à-dire des prénotions ? Mais il est impossible d’appliquer les prénotions aux réalités correspondantes si on ne les a pas distinctement expliquées et si l’on n’a pas examiné quelle réalité il faut ranger sous chacune d’elles. »
Épictète, Entretiens, Livre II, 17, 1-7
Puisque nous souffrons de nos désirs et aversions, et agissons de manière inappropriée, parce que nous sommes mauvais dans l’application des prénotions aux situations particulières, il faut donc s’assurer que les principes appris à l’école soient remémorés avec succès et appliqués correctement dans les situations qui se présentent. Pour ce faire, il faut appliquer les prénotions aux cas particuliers conformément à la Nature, c’et-à-dire. conformément à une règle.
« Mais puisque tu crois appliquer correctement les prénotions aux cas particuliers, dis-moi maintenant d’où tu tiens cette conviction ? –C’est que je crois qu’il en est ainsi. – Mais tel autre ne le croit pas, et il pense lui aussi faire une application correcte, oui ou non ? – Il le pense, oui. – Est-il possible, quand il s’agit de points sur lesquels vos avis se contredisent, que vous appliquiez tous deux correctement vos prénotions ? – Non. –Peux-tu alors nous indiquer, pour une meilleure application des prénotions, quelque chose de supérieur au simple fait que tu le crois ? […] Voici le commencement de la philosophie : la conscience du conflit qu’il y a entre les hommes, la recherche de l’origine de ce conflit, la condamnation de la pure et simple opinion et la suspicion à son endroit, une sorte de mise à l’épreuve de l’opinion pour tester sa validité, l’invention d’une règle comparable à l’invention de la balance pour les poids ou à celle du cordeau pour les lignes droites et courbes. »
Épictète, Entretiens, Livre II, 11, 10-13
Nous allons maintenant découvrir, en retournant à l’analyse de Valéry Laurand sur l’extrait de l’Entretien de Musonius Rufus, en quoi consiste cette règle pour ce qui est de la peine et du plaisir.
Le plaisir n’est pas un bien
Une première distinction est faite par Valéry Laurand en page 86 entre le bien et l’utile, entre ce qui guide respectivement le choix de l’action appropriée pour garantir la vie vertueuse et celui de l’action adaptée pour garantir la préservation de sa propre constitution.
« Avec la première démonstration, il s’agit de choisir le bien, non pas de sélectionner l’utile, comme cependant les premières tendances données par la nature nous y invitent (c’est la distinction entre ἐκλογή, selectio et αἵρεσις, expetendum explicitée par exemple par Cicéron dans le De Finibus [2]). Le plaisir, indique Musonius, n’est pas à choisir (et en cela il s’oppose évidemment aux épicuriens), en revanche, le bien, lui, doit être choisi. »
Valéry Laurand rappelle que c’est grâce à la vertu qu’il est possible de faire un bon usage des indifférents. Il explicite ensuite la démonstration logique utilisée par Musonius Rufus reposant justement sur cette distinction entre ce qui est à sélectionner et ce qui est à choisir.
« Que le bien soit à choisir est évident, de soi-même, connu, parce que c’est là la fin même d’une vie rationnelle : choisir le bien, s’attacher à la nature rationnelle, à son ordre et à son harmonie. Le choix en ce sens dérive de la sélection des choses conformes à la nature, mais il la dépasse : c’est en choisissant le bien (la vertu) que toute sélection dans les indifférents devient nécessairement conforme à la nature. La démonstration de Musonius, s’ordonne donc ainsi :
Le bien est à choisir (prénotion forgée par l’expérience de la consécution entre les sélections des choses utiles à la vie).
Certains plaisirs ne sont pas à choisir (on peut en faire l’expérience).
Donc le plaisir n’est pas un bien.La démonstration se déroule selon deux axes : un critère logique, sous-tendu par une expérience morale qui joue le rôle de norme et qui permet de distinguer finalement plaisir et bien. »
Valéry Laurand indique en pages 87 et 88 comment Épictète, se souvenant sans doute de l’enseignement de son maître, fera également à son tour appel à une démonstration logique pour enseigner ce principe et montrer l’utilité de l’application de la logique en vue de l’éthique.
« On peut penser ici à la démonstration d’Épictète, plus précise, plus longue (parce que plus développée, en deux mouvements qui permettent une même conclusion), mais moins incisive sans doute :
« Le bien doit-il être tel qu’il faut avoir confiance en lui et se laisser mener par lui ? – Oui. – Faut-il nous fier à une chose instable ? – Non. – Le plaisir est-il une chose stable ? – Non. – Enlève donc ; jette-le hors de la balance ; chasse-le très loin du pays des biens. Si tu n’as pas le regard perçant, si une raison ne te suffit pas, prends-en une autre. A-t-on à être fier d’un bien ? – Oui. – Et a-t-on à être fier de la présence d’un plaisir ? Prends garde ; ne va pas dire oui ! Sinon je croirai que tu ne mérites pas d’user de la balance. »
Épictète, Entretiens, Livre II, 11, 20-23.Épictète partage les arguments de son maître et fait dépendre la logique de la morale. Avant lui, Musonius liait aussi dans la démonstration logique et éthique, l’éthique orientant la logique et la logique rendant raison de l’éthique et le manifestant. Cette mutuelle implication du jugement et de l’impulsion, du logique et de l’éthique, rend compte de ce que V. Goldschmidt traduit par « dépendance réciproque » (anakolouthia) des parties du système stoïcien, traduite dans le temps par la conséquentialité dans la logique et dans les actions. On comprend alors que la logique, intermédiaire entre l’expérience vertueuse et la vertu comme norme, ne peut avoir sa fin en elle-même. Elle est partie de la philosophie et doit pour cela être dans une relation d’interdépendance avec les autres parties (physique, éthique) et le philosophe ne saurait l’absolutiser. Enracinée dans l’expérience, dans la pratique, la logique doit ordonner cette expérience en vue du bien : pour cela, elle permet le développement du « germe de vertu » en chacun de nous et le rend visible. »
La démonstration précédente repose sur la prénotion du bien. Chaque prénotion vient avec certaines marques distinctives, comme le mentionne Épictète dans Entretiens, Livre II, 11, 16 : « Comment serait-il possible que ce qu’il y a de plus nécessaire chez les hommes ne possède pas de marque distinctive, et que nous n’ayons pas le moyen de le découvrir ? »). La prénotion de bien en implique au moins deux : être digne de confiance et être digne d’exaltation. Ces marques distinctives permettent de réfuter au plaisir la prétention d’être un bien.
La forme logique permettant de peser les possibles biens sur une balance se présente donc ainsi :
Si quelque chose est un bien, nous pouvons y placer notre confiance
Si nous pouvons placer notre confiance dans quelque chose, alors cela doit être stable
Donc, si quelque chose est un bien, il doit être stable (syllogisme hypothétique)
Le plaisir n’est pas stable
Donc, le plaisir n’est pas un bien
On reconnaît dans les trois dernières phrases la forme logique argumentative appelée modus tollens qui peut être énoncée ainsi :
Si A, alors B
Non-B
Donc, non-A
Marc Aurèle lui-même, au milieu de ses nombreuses remémorations sur le sujet du plaisir, fait également appel à la logique, peut-être se souvenant d’une des démonstrations enseignées par son maître Rusticus, pour se convaincre que le plaisir n’est pas un bien. Ainsi au Livre VIII, 10 de ses Pensées (trad. M. Meunier modifiée par C. Veillard), il écrit :
« Le repentir est un blâme pour avoir négligé l’utile ;
Or le bien est utile ;
Mais on ne se blâme pas d’avoir négligé un plaisir ;
Donc le plaisir n’est ni utile ni bon. »
Intéressons-nous maintenant à la manière d’aborder la peine et quelle règle logique est à appliquer.
La peine n’est pas un mal
Valéry Laurand souligne tout d’abord en page 88 que la prénotion du mal associée à la peine ne peut pas être abordée de la même manière que celle du bien associée au plaisir :
« Que la peine ne soit pas un mal n’est pas directement convaincant, ou vraisemblable. Lorsque l’on compare cette démonstration à la précédente, il semble que l’on change de registre : nous ne sommes plus dans le gnorimon, parce que l’homme ne dispose pas de prénotion spécifique sur ce point (l’idée de bien supplée pour ainsi dire à toute notion du mal, en la rendant non nécessaire). La peine n’est pas un bien : elle n’est, seulement, pas un mal. […] Ni bien, ni mal, elle est finalement indifférente et pour cela dans l’ordre du relatif. Musonius souligne en revanche le fait qu’elle constitue souvent un préférable : là encore, il n’est pas Cynique, ou du moins n’est-il pas Antisthène soutenant que la peine est un bien (D.L. VI, 2.). […] Il s’agit là (« beaucoup de peines ne sont pas à fuir ») d’une de ces vérités dont Sénèque dit qu’elles gagnent en évidence à force d’être ressassées (Sénèque, Lettres à Lucilius, Lettre 94, 26), mais qui demeurent dépendantes des circonstances. Si l’on peut conclure ici que la plupart des peines ne sont pas à fuir, on ne saurait cependant conclure qu’aucune n’est à fuir, car certaines le sont effectivement. »
On retrouve le même genre de démonstration utilisée par le disciple de Musonius Rufus, mais cette fois appliquée à la mort. En effet, Épictète développe cet argument :
« Lorsque tu te représentes la mort comme un mal, tiens prête l’idée que le mal est ce qu’il convient d’éviter, et que la mort est inévitable. »
Épictète, Entretiens, Livre I, 27, 7
Recevant la représentation que la mort est un mal, nous devons avoir à portée de main la représentation de la prénotion du mal, que c’est une chose à éviter, et celle de la mort, que c’est une chose inévitable. Constatant que la même chose ne peut pas suivre des mêmes prénotions, nous devons alors refuser d’assentir à la représentation que la mort est un mal.
La forme logique de cet argument se présente donc ainsi :
Si quelque chose est un mal, il doit être évité (condition nécessaire d’une prénotion nette du mal)
Si la mort est un mal, elle doit être évitée (instanciation)
Si la mort doit être évitée, elle peut être évitée
Donc, si la mort est un mal, elle peut être évitée (syllogisme hypothétique)
La mort ne peut pas être évitée
Donc la mort n’est pas un mal
On retrouve là également dans les trois dernières phrases la forme logique argumentative appelée modus tollens. Il est tout à fait possible de l’appliquer au cas de la peine ainsi :
Si quelque chose est un mal, il doit être évité
Certaines peines ne sont pas à éviter
Donc la peine n’est pas un mal
Dans la suite de son analyse en pages 88 et 89, Valéry Laurand clarifie le sens du mot « ponos » employé par Musonius Rufus :
« Ce n’est pas là simplement l’affaire de l’ambiguïté du mot ponos, justement et orgueilleusement, puisque les ressources du latin sont ici plus riches que celles du grec, soulignée par Cicéron dans les Tusculanes :
Il y a une différence entre l’effort (laborem) et la douleur (dolorem). Ce sont choses tout à fait voisines, mais il y a néanmoins une distinction à faire : l’effort est une fonction déterminée soit de l’âme, soit du corps, qui comporte une activité physique et morale relativement pénible ; la douleur, elle, est un mouvement rude qui se produit dans nos corps et répugne à nos sens. Pour ces deux notions, les Grecs, dont la langue est plus riche (copiosior) que la nôtre, n’ont qu’un seul terme. […] Ô combien parfois ton vocabulaire est pauvre, ô Grèce, qui te figures avoir des mots de reste ! [Je le répète : une chose est la douleur, autre chose est l’effort].
Cicéron, Tusc. II, 35Si effectivement la douleur est un indifférent et même si la nature a donné à l’homme une impulsion à éviter celle-ci (Cicéron, Fin. III, 62), l’effort lui-même pour Musonius doit être divisé entre effort utile et effort inutile et il consiste parfois pour le philosophe à supporter la douleur – il partage là l’avis de Cicéron : « Il y a néanmoins entre ces deux choses quelque ressemblance : l’habitude de l’effort (laborum perpessionem) en effet, facilite la résistance à la douleur (dolorum faciliorem)(Cicéron, Tusc. II, 35.). » D’où mon choix de traduction pour πόνος, que je rends le plus souvent par « peine » : cela préserve une ambiguïté que Musonius veut sauvegarder – il utilise souvent κακοπαθεῶ (souffrir de son corps) ; l’expression française « prendre de la peine » implique la volonté de faire effort, voire de supporter la douleur pour le but qu’on se fixe, ce qui correspond assez bien aux propos de Musonius. »
On ne s’étonnera donc pas de retrouver chez Chrysippe une vertu dénommée « φιλοπονία » (philoponia), qu’on pourrait traduire par « goût de l’effort », dans la liste des vertus rangées sous celle générique de courage et qui nous a été rapportée par Stobée et Andronicos de Rhodes. La définition de cette vertu est la suivante : qualité qui fait qu’on ne peut pas être dissuadé par la difficulté ou la douleur de faire dans une situation concrète ce qu’on sait devoir être fait. Marc Aurèle fait d’ailleurs référence à cette vertu lorsqu’il rend hommage à son père au Livre I, 16 de ses Pensées :
« De mon père : la mansuétude, et l’inébranlable attachement aux décisions mûrement réfléchies ; l’indifférence pour la vaine gloire que donne ce qui passe pour être des honneurs ; l’amour du travail (φιλόπονον) et la persévérance […]. »
Ainsi, de cette manière, comme l’écrit dans la suite de son analyse Valéry Laurand en pages 89 et 90 , la peine devient un instrument de cette vertu.
« De cette ambiguïté et du statut mouvant de la peine découlent à la fois une démonstration qui n’a plus pour objet le connu mais le vraisemblable (vraisemblable parce que relatif et dépendant des circonstances) et une conclusion qui devrait comporter « quelques peines ne sont pas à fuir ». Si la peine n’est pas à fuir, elle est pour Musonius l’instrument de la vertu :
D’où il me vient à l’esprit de dire que celui qui ne veut pas supporter de peine (ὁ μὴ θέλων πονεῖν) prononce presque (σχεδόν) contre lui-même ce jugement qu’il n’est digne d’aucun bien (μηδενὸς εἶναι ἀγαθοῦ ἄξιος), puisque tous les biens, c’est par la peine que nous les acquerrons.
Musonius, VII, p. 31, 9-11Mais précisément, Musonius prend le soin de nuancer le propos (σχεδόν) et il ne s’agit pas de n’importe quelle peine, de n’importe quel effort :
Combien est-il plus vrai, alors, que nous montrions fermeté et endurance (ἀνέχεσθαί τε καὶ καρτερεῖν), lorsque nous savons que nous souffrons pour une cause honnête, soit pour porter secours à des amis, ou bien pour être utile à la cité, ou pour défendre femme et enfants et, ce qui est le plus grand et le plus important, pour être bons, justes et sages, ce qui n’advient à personne sans peine.
Ibid., l. 3-9.L’effort, la peine, qu’il faut préférer, c’est ceux qui, rétablissant les cercles de l’oikeiôsis dite sociale (nous y reviendrons longuement : il s’agit du cercle de la famille, celui des amis, celui de la cité), mènent à la vertu. »
La peine en définitive, loin d’être un mal, se trouve être en fait une opportunité d’exercer la vertu, et de transformer donc cet indifférent en un bien.
Comme le résume très bien Valéry Laurand en page 66 de son même ouvrage Stoïcisme et lien social : « [L]e nœud de l’enseignement moral de Musonius : prendre de la peine pour la vertu, être philoponos, c’est vivre la vertu, en faire l’expérience et donc ne pas se contenter de discours vides, mais aussi, par là même, adapter son corps à la vertu. ».
Synthèse
En partant de l’extrait de l’Entretien de Musonius Rufus, et de son analyse par Valéry Laurand dans son ouvrage Stoïcisme et lien social, nous avons envisagé ce qui aurait pu être enseigné à Marc Aurèle à propos de la peine et du plaisir, et à quoi il avait donné son assentiment. Junius Rusticus, philosophe stoïcien et conseiller de Marc Aurèle, lui a sans doute présenté certaines règles s’appuyant sur des démonstrations logiques pour appliquer correctement les prénotions de bien et de mal aux cas particuliers, dont on peut retrouver un exemple au Livre VIII, 10 de ses Pensées.
On retrouve ici de manière concrète comment les deux parties de la philosophie stoïcienne, à savoir d’une part la logique, de par la définition des prénotions et leur application selon une règle établie, et d’autre part l’éthique, par l’accomplissement d’actions convenables, sont intriquées. L’exemple exposé dans cet article à propos de la peine et du plaisir montre l’importance des démonstrations logiques auxquelles il faut donner son assentiment afin d’arriver ensuite à un jugement correct permettant d’agir de manière appropriée en toutes circonstances. Épictète, disciple de Musonius Rufus, qui lui enseigna l’importance de la logique (l’anecdote racontée par Épictète au chapitre 7 du Livre I des Entretiens à propos d’une omission dans un syllogisme montre à quel point Musonius Rufus était intransigeant sur ce sujet), avait bien retenu cette leçon et l’enseigna à son tour :
« Quand il s’agit de poids ou de mesures, nous ne nous contentons pas non plus de la simple apparence, mais pour chaque cas nous avons inventé une règle. Comment serait-il possible que ce qu’il y a de plus nécessaire chez les hommes ne possède pas de marque distinctive, et que nous n’ayons pas le moyen de le découvrir ? C’est donc qu’il y a une règle. Pourquoi alors ne la cherchons-nous pas, ne la découvrons-pas et, une fois que nous l’avons découverte, pourquoi ne nous en servons-nous pas, sans la transgresser, sans nous en écarter fût-ce pour tendre le doigt ? C’est cela, je pense, dont la découverte délivre de leur folie ceux qui en tout domaine se servent uniquement de l’opinion comme mesure ; le but étant que désormais, partant d’éléments connus et distingués avec soin, nous nous servions, dans l’application aux cas particuliers, de prénotions bien analysées. »
Épictète, Entretiens, Livre II, 11, 15-18
[1] De manière identique à Valéry Laurand, j’ai retenu le terme « peine » plutôt que « douleur » pour la traduction du mot grec πόνος.
[2] Cicéron, Fin. III, 16-22
Crédits: Photo by Clique Images on Unsplash.
